AMICALE DES RETRAITES DE SOGREAH
Texte de Bernard Simon
Juin 2017

Le monde musulman – qu’il soit arabe ou non - n’est plus celui que j’ai pu connaitre dans la période 1968-86. J’ai en effet eu à intervenir ; en dehors de l’Afrique, dans des pays aussi divers que Liban, Etats du golfe persique, Sri Lanka, îles Maldives, Malaisie, Indonésie.
C’est pourquoi j’ai pensé à rappeler ici quelques souvenirs de mes aventures dans ces petits états du golfe persique où peu de collègues du CIRAD ont dû avoir l’occasion de travailler, en dehors des anciens de l’IEMVT. Ces anecdotes tournent essentiellement autour de l’Emirat d’Abu Dhabi dans lequel j’avais eu la responsabilité d’un projet de « reforestation » initié par le cheikh à l’aube de l’indépendance de son pays.
1 – Le contexte du projet
Il faut, en préambule, rappeler qu’à l’époque lointaine (1969-71) d’où proviennent ces souvenirs, les Emirats du golfe persique étaient encore appelés « Trucial states » (Etats de la trêve), noms qu’ils portaient lorsqu’ils étaient sous protectorat anglais. Indépendants en 1971, depuis que Harold Wilson, Premier ministre de Grande Bretagne, avait déclaré : « plus un soldat anglais à l’Est d’Aden ! », ils commençaient tout juste à s’autogouverner sans être encore maîtres de leurs ressources pétrolières en voie d’exploitation (à Tarif et djebel Dana pour Abu Dhabi). Leur union intervint plus tard mais, à l’époque, c’était du « chacun pour soi » teinté des vieilles rivalités, fruit des incessantes guerres qu’ils se faisaient entre eux avant la trêve imposée par les Anglais. Ils cherchaient où, quoi et comment investir les revenus qu’ils commençaient à retirer du pétrole, pour moderniser leur pays.
Ces petits états vivaient auparavant de la pêche des perles dont le commerce se faisait par le port de Djebel Dana et de la pêche des poissons.
Bien que les prospections aient commencé en 1935, le pétrole n’avait été découvert sur l’île de Das qu’en 1956 et les premiers pétroliers quittèrent cette île en 1962 et Djebel Dana, le principal gisement in shore, dès 1963.
Le cheikh Zayed bin Sultan al Nahyan (je ne donne que cette fois son nom développé); père du cheikh actuel) était, du vivant de son père, gouverneur de la province de l’est et résidait à « Al Aïn » (la source) qui en était la capitale. Abû Dhabi n’était à l’époque qu’une petite ville située sur l’île du même nom rassemblant autour du palais royal famille du cheikh, notables de l’émirat, commerçants et serviteurs pour ne pas dire esclaves. Il ne vint s’installer à Abu Dhabi que lorsqu’il fut appelé à régner en 1966, année où l’île fut reliée par un pont à la côte, mais resta très attaché à sa ville et à sa région.
Ma première responsabilité comme chef du service « Agriculture » de la SOGREAH, fut la mise en route puis la direction de cet énorme projet ***qui venait d’être remporté dans l’émirat, à la suite d’un pari un peu fou de notre génial et prophétique Directeur Général: « Faire fleurir le désert » ! soit, en termes plus concrets, planter et faire pousser des arbres (400 ha), le long de l’autoroute de 160 kilomètres qui venait d’être construite en plein désert entre la capitale et la bourgade d’ Al Aïn, demeurée résidence d’été du cheikh Zayed.

Le site d’Al Aïn était en effet plus « frais » à la saison chaude car il était de moyenne altitude – quelques dizaines de mètres - sur les contreforts de la petite chaîne montagneuse formant frontière avec le sultanat d’Oman, et recelait quelques sources prolongées par des « foggaras » (c’est le nom donné en Afrique du nord à ce genre de conduites souterraines et je crois qu’elles étaient appelées ici « aflaj ») coulant de temps à autre car alimentées par les pluies tombant sur le relief coté Oman.D’ailleurs, une ferme maraîchère y fut réalisée ultérieurement par TOTAL (rappelons que TOTAL était encore à l’époque la Compagnie Française des Pétroles) en guise de « cadeau » au cheikh.
Son étude avait été faite par SOGREAH (Jean Branet) et sa direction confiée à l’ancien responsable des pépinières de notre projet qui venait des pépinières « Treyves » à Moulins.
En revanche, la nappe située sous le trajet de l’autoroute dans laquelle nous devions puiser l’eau nécessaire à l’irrigation de notre future « forêt » était fossile – donc pratiquement sans ré alimentation naturelle par des pluies quasi inexistantes - et son niveau ne devait baisser, selon le contrat, que d’un mètre par an au maximum.
***
Irrigation au goutte à goutte dans l’Emirat d’Abu Dhabi .Les plantations d’Eucalyptus le long de l’autoroute qui va d’Abu Dhabi à Al Ain ont été réalisées en 1969-CM

Nous devions faire en sorte que le cheikh en se rendant à Al Aïn, ait l’impression de traverser une forêt. D’ailleurs, lors de l’unique entretien qu’il m’avait accordé en trois ans (en pleine nuit sous sa tente d’apparat et justement à Al Aïn), il m’avait confié son admiration pour les forêts françaises, en particulier celle de Fontainebleau.
Or les maigres ressources en eau dont nous pouvions disposer, même en utilisant l’irrigation au goutte à goutte qui était encore expérimentale et mal contrôlée, qu’il fallait combiner avec les rares espèces et variétés d’arbres et arbustes adaptées au climat, à la sécheresse, à l’eau salée et… aux chameaux, ne nous permettaient que de disposer astucieusement , en profitant du micro-relief dunaire, des bandes arborées de 25 à 50 mètres de large donnant l’illusion visuelle d’une forêt épaisse.

Au début de ce projet dont la réalisation devait durer trois ans, tout était à inventer, à fabriquer sur place ou à importer, même la main d’œuvre !
C’est Robert Jaminet qui a introduit le système d’irrigation au goutte à goutte dans l’Emirat d’Anu Dhabi en 1969.Les plantations d’Eucalyptus le long de l’autoroute qui va d’Abu Dhabi à Al Ain ont été réalisées par lui. Dans les années 80 il fut chargé de l’épineux problème de la contamination des nappes d’eau par les excès de nitrate en Bretagne.CM
2 - La fine équipe du projet
Les Abu-Dhabiens de souche étaient déjà très peu nombreux sans toutefois être submergés comme maintenant par la main-d’œuvre importée. Ils étaient restés de grands nomades et peu d’entre eux étaient devenus urbains. En dehors des riches familles nobles toutes plus ou moins alliées à la famille royale, seuls les commerçants des souks, les fonctionnaires et quelques employés étaient apparemment du pays. D’ailleurs, le cheikh, très attaché lui même au mode de vie nomade et à l’élevage des dromadaires, avait initialement songé à confier à SOGREAH la création d’oasis artificiels autour des forages. Ils auraient du permettre à ses sujets de continuer une vie nomade facilitée par une semi sédentarisation (eau saine et abondante, constructions en dur, horticulture irriguée).
On avait même songé à électrifier ces oasis (mais l’énergie solaire était encore balbutiante), apportant ainsi gratuitement lumière et énergie pour le pompage et… la climatisation ! ce dont bénéficiaient déjà les habitants de la capitale.
On était donc en situation de plein emploi et les rares nationaux disponibles se voyaient réserver les postes dans différents service (planton, gardien, éventuellement faiseur de café, guide ou chauffeur de maître).
Comme nous n’avions pas besoin de ce genre d’employés, tout le personnel permanent du projet était étranger :
L’équipe de base était française, jeune et célibataire (sauf le directeur local, ingénieur maison de SOGREAH, que son épouse avait rejoint dès que l’existence était devenue vivable) Les hommes clés étaient le chef mécanicien, le poseur de tuyaux et le pépiniériste.
Les cadres intermédiaires étaient libanais ou syriens généralement bien formés.Ils avaient l’avantage de parler arabe, français et anglais. C’est ainsi que le chef des chefs et « conciliateur » régleur de palabres était un Libanais, beau gosse (Antoine ?) qui ressemblait à Omar Sharif et prétendait en être le cousin.Les trois autres chefs d’équipe chargés des plantations étaient des Libanais chrétiens de la montagne et vraies forces de la nature.La secrétaire était syrienne et musulmane.
Les ouvriers spécialisés qui installaient les pompages et les réseaux d’irrigation étaient des tunisiens que nous avions amenés avec nous car ils avaient eu l’expérience du précédent projet du même ordre : la base de vie d’Hassi Messaoud et étaient sensés parler arabe. Mais leur arabe dialectal n’ayant pas grand chose à voir avec celui d’Abu-Dhabi et encore moins avec celui des ouvriers, pour la plupart pakistanais, ils repartirent rapidement.
La main d’œuvre de base, peu fidèle et peu disciplinée, venait du Pakistan mais aussi des Emirats voisins (Sharjah, Ra’s Al-Khayma…),Koweït,Oman et quelques uns de l’Arabie Saoudite voisine.
J’avais donc affaire, moi qui était «nouveau » dans la boutique et qui n’avait jamais mis les pieds au Proche Orient, à une équipe hétéroclite, véritable tour de Babel, peu disciplinée mais jeune, aventureuse et pleine d’allant. Il fallait certainement des hommes de ce calibre pour mener à bien un projet dont ses promoteurs avaient sous-estimé les difficultés.
En effet, une fois surmontés les aléas du début, la machine SOGREAH se mit à tourner et, en définitive, je fus vite adopté et reconnu comme le « patron » vu mon âge (j’allais avoir 44 ans contre 25 ans de moyenne de l’équipe). J’eus d’ailleurs plus de difficultés avec certains des spécialistes, « maison » comme de l’extérieur, qui venaient en mission d’appui.
De SOGREAH, j’ai eu à utiliser les compétences de plusieurs collègues et, en particulier, d’un camarade pédologue(Simon Toujan) pour l’étude des « sols » qui revenait le soir en disant « je cherche toujours un sol ».

Lindsay Pryor visite le jardin du Lautaret avec Simon Toujan en 1965-
Diapo Bernard Simon
A l’extérieur, je fis appel : pour le choix des espèces et l’examen de leur comportement in situ, à un vieil ami forestier OM venant de la SEDES après une carrière à Madagascar et au Brésil et, pour la prospection botanique de la région, à un spécialiste de l’IEMVT.
Il ne faut pas oublier, malgré des rapports parfois compliqués et/ou difficiles, l’aide qui nous fut apportée dans les domaines du « goutte-à-goutte », appelé à l’époque par l’un de ses deux noms anglais « drip » ou « trickle » irrigation, par les Israéliens de l’université de Rehovot rencontrés à Grenoble ou bien dont l’expérience nous parvenait par nos partenaires Australiens, et surtout celle des Australiens eux-même qui fut déterminante.
En effet, non seulement les Australiens nous ont fait bénéficier des résultats de leurs expérimentations de l’irrigation au goutte-à-goutte dans les vignobles et les plantations d’agrumes des régions de Perth et d’Adélaïde, mais ils nous ont fourni le matériel d’irrigation d’origine israélienne qui avait retrouvé la « virginité » indispensable pour pouvoir être utilisé en pays musulman.
Leur expert, prénommé Donald, était de fait un viticulteur ; il était très compétent mais il avait un accent hyper-australien qui le rendait quasi-incompréhensible et il aimait trop la « dive bouteille », ce qui n’était pas recommandé en terre d’Islam, même tolérante.
Ma seule connaissance de cette forme nouvelle d’irrigation résultait en effet d’une visite des jardins de bord de mer de la ville nouvelle de La Grande Motte équipés de la sorte par le BCEOM !
En outre, la science du plus célèbre des «eucalyptologues», le professeur Lindsay Pryor, doyen de l’université de Canberra, qui vint nous apporter ses conseils sur le terrain fut fondamentale. Il nous aida considérablement dans le choix des variétés d’eucalyptus à utiliser, beaucoup plus large que celui que nous donnait notre expérience d’Afrique du Nord, et nous fit fournir gratuitement les semences des variétés préconisées.
 Lindsay Pryor, doyen de l’université de Canberra
Lindsay Pryor, doyen de l’université de Canberra

Lindsay Pryor visite le jardin du Lautaret avec Simon Toujan en 1965
Diapo Bernard Simon
Je n’avais pas à me préoccuper des hydrogéologues, hydrologues et hydrauliciens, petit monde à part, dirigés par leurs chefs de service ; nos rapports avec eux concernaient surtout la quantité et la qualité (salinité) de l’eau des forages qui conditionnait les surfaces des bandes forestières et les espèces et variétés à y planter.
Au début, nous logions à six par six dans des tentes de l’armée pakistanaise sur lesquelles avaient été installés tant bien que mal des climatiseurs donnant une sensation de fraîcheur « très relative ! » à la saison chaude avec 45° à l’ombre dehors.
Nous étions nourris à la libanaise par les frères Abéla, maltais qui débutaient dans le cathering des bases de vie pétrolières, et étions saturés de « falafel sauce taratour » et autres boulettes, les « kébabs » étaient rares, les légumes absents sauf les salades et c’est là que j’ai appris, pour le retrouver plus tard en Egypte, qu’un légume de choix était le riz aux vermicelles grillés.
Quant au pain « Bédou », galette non levée et molasse, elle n’était acceptable que grillée au petit déjeuner. On a pu améliorer rapidement nos conditions de vie grâce à l’installation de cabines préfabriquées, genre « Algeco » avec eau courante et cabines de douche, électrifiées et climatisées. Nous eûmes bientôt notre propre cantine qui devint tout à fait correcte avec l’arrivée de l’épouse du responsable local après de multiples changements de cuisinier.
Ne venant sur place que deux ou trois fois par an dont une en été, cette existence était tenable pour moi. Mais, pour les permanents, cette vie de travail intensif, sous un climat très dur et sans distractions était difficile à supporter malgré les conditions de repos qui leur étaient faites (congé d’une semaine par mois à Beyrouth et un mois tous les six mois en France).
Aussi faisaient-ils toutes les bêtises possibles: combat de scorpions d’une espèce très dangereuse, sous les tentes à la sieste, rodéos dans le désert entre les dunes comportant descentes en vol plané avec nos Toyota Corolla ou Peugeot 404 qui n’en pouvaient pas tant, ascension (ratée) du djebel d’Oman (dj.Akhdar ou Hafit ?) en partant trop tard et en plein mois de juillet, sans provision d’eau suffisante. A la saison chaude, on travaillait de 5 heures - 5heures 30 jusqu’à 10 - 11 heures tout en consommant 10 à 12 litres d’eau par jour et en absorbant plusieurs tablettes de sel. En cas d’urgence – attaque de chameaux, par exemple - on retravaillait après le coucher du soleil.
Nos jeunes lascars ne respectaient pas les consignes avec pour résultat des évacuations sur Beyrouth ou Amman pour des déshydratations plus ou moins graves et même des rapatriements définitifs. Même les baignades dans le Golfe n’étaient pas agréables tant la mer était chaude et si salée qu’on ne pouvait y plonger.
Un de nos jeunes, plongeur émérite et chasseur sous marin, arrivait à plonger en saison fraîche, bardé de gueuses de plomb pour rapporter du poisson à la cantine. C’est la que j’ai appris à apprécier et à distinguer le « Red Snapper » très savoureux du « Yellow Snapper » beaucoup moins bon.
Finalement, ce fut une belle période de mon existence, l’une des rares ou j’ai eu à travailler en équipe depuis mon départ du Cameroun et j’en garde un excellent souvenir marqué toutefois par une de mes rares soûleries car, à la fin de ma dernière mission, l’équipe avait décidé de saouler le « patron » et ils y ont presque réussi. J’ai pu quand même regagner ma cabine sur deux jambes, très digne, et y faire ma valise. Le lendemain, je n’étais pas frais et j’ai mis deux jours à m’en remettre à Beyrouth !
3 - La présence anglaise rémanente
Les Anglais n’étaient officiellement plus les maîtres et se faisaient discrets mais ils étaient encore omniprésents et, à ce propos, je vous livre six anecdotes :
Notre banque sur place était l '« Ottoman branch » (en France, la Banque Ottomane) , filiale de je ne sais plus quelle banque française.Tout son personnel était anglais et, en sous-ordre, Indien. Le chef d’agence était un jeune anglais plutôt sympathique, francophile et très légèrement francophone. Nous avions quelques relations extra professionnelles avec lui et sa femme. Or, ils refusaient toujours le whisky proposé à l’heure de l’apéritif en disant « never before sunset » Mais, at home, le soleil devait se coucher très tôt car on retrouva, un après midi, leur voiture encastrée dans l'un des rond-points de la ville tandis qu’ils ne réapparurent que deux jours plus tard, sortant de l’hôpital « british, of course » honteux et confus et assez abîmés ! Toute la communauté occidentale, sauf les Anglais, en rigola longtemps.
J’eus d’ailleurs à fréquenter cet hôpital pour me faire enlever un gros bouchon de cérumen provoqué par le sable, la chaleur et le vent. Je fus reçu par un médecin militaire anglais – un « Major » m’a-t-on dit- en uniforme type « Armée des Indes » et aux grosses moustaches en guidon de vélo. Il semblait n’avoir jamais vu de Français et, curieux, commença par m’interroger sur ce que je pouvais bien faire dans cette terre britannique.
Selon lui, je ne pouvais être que dans la cuisine, la mode ou l’art; aussi fut-il très étonné d’apprendre que je plantais des arbres dans ce désert qui lui était si familier. Il se vantait de n’être pas rentré en Angleterre depuis 15 ans et comptait n’y retourner que pour y prendre sa retraite ! Cet échange terminé, il me coucha « manu militari » - c’est le cas de le dire – sur une table d’examen et me débarrassa prestement de mon bouchon à l’aide d’un entonnoir et d’un broc d’eau chaude tout en m’inondant abondamment !
ll nous fallut plus d’un an, grâce à l’aide de notre banquier, pour pouvoir être « invités » - et non acceptés - comme membres au « British club » qui avait l’avantage de disposer d’une piscine d’eau douce. Nous y étions visiblement indésirables et snobés par les jeunes anglais qui monopolisaient les cabines et les fauteuils. Et l’eau n’était même pas fraîche !
Une petite compagnie d’aviation, la « Gulf Aviation », assurait des liaisons approximatives entre les Emirats et les différents pays de la région. Elle avait été créée par d’anciens pilotes de la R.A.F. qui naviguaient sur leurs vieux coucous d’un Emirat à l’autre, quand bon leur semblait et s’ils jugeaient que leur appareil était en état de voler ; ils en avaient vu d’autres !
Avec leurs grosses bacchantes et leurs combinaisons défraîchies, toujours entre deux whiskies, ils semblaient sortis d’un autre monde défunt.
Cette compagnie nous valut bien des déboires et, pour moi, de passer une nuit à l’aéroport de Bahreïn, à tel point qu'un jour, à bout de patience, nous fimes scandale en défilant à la queue leu-leu dans la salle d’embarquement d’Abû Dhabi en criant « if you want to cross the Rub’al-khâli, take a camel, not Gulf aviation! »
* Curieusement, on ne jouait pas au cricket dans l’Emirat, pourtant proche du Pakistan et de l’Inde où ce vieux jeu anglais était devenu sport national. Le polo, très en faveur au Pakistan, n’était pratiqué qu’à Al Aïn et par les membres de la famille du cheikh. En revanche, les Anglais avaient trouvé le moyen de jouer au golf dans ce quasi désert sans être trop regardants sur la qualité du terrain et du parcours. Ils avaient choisi une zone au relief acceptable et stabilisé le sable avec du pétrole brut ! Ils y jouaient très tôt sans herbe, ni eau et sans caddies.
Enfin, bien que possesseur d’un permis de conduire international, j’ai du repasser mon permis de conduire (çà m’était déjà arrivé en Guinée) mais ce ne fut qu’une simple formalité qui n’avait que le but de faire rentrer de l‘argent dans les caisses de l’Etat. On ne voyait d’ailleurs pas où exécuter un créneau, respecter un stop ou une limitation de vitesse et les panneaux de signalisation étaient rares. Ils ne mentionnaient même pas les passages de chameaux ! Quoi qu’il en soit, je suis très fier de ma « driving licence », très british bien qu’écrite en arabe, et j’ai été parfois tenté de la présenter en France lors d’un contrôle routier.
4 - Les luttes inter-religieuses mais chrétiennes
Contrairement à tous les autres pays du golfe, Abu-Dhabi était déjà d’un islam sunnite assez tolérant. Ainsi les non-musulmans pouvaient acheter, détenir et boire de l’alcool. Mais, pour ce faire, on devait demander une sorte de « bon d’achat » qui en fixait la quantité en fonction de la taille de la famille. Il était même possible d’inviter un musulman « Abu-dhabien » ou originaire d’un pays bien considéré (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie…) à boire un apéritif chez soi ou, le plus souvent, à l’hôtel, sauf le vendredi.
De même, l’Emirat était très tolérant à l’égard des religions chrétiennes. Ainsi, il n’y avait pas de police religieuse comme en Arabie Saoudite ou au Koweït. En revanche, une guerre sourde mais virulente avait lieu entre catholiques et protestants.
Le long de la corniche du bord de mer Cheikh Zayed, tolérant mais soucieux d’impartialité, avait donné deux terrains contigus d’égale superficie aux églises anglicane et catholique pour y édifier leurs lieux de culte.
La corniche fut construite seulement en 1969 et surnommée « la Croisette » par les Anglais du cru et la «Promenade des anglais » par nous,
Un temple et une église avaient donc été construits côte à côte, chaque communauté s’efforçant par ses dons de faire plus et mieux que l’autre; d’où une débauche d’images pieuses, de statues, de girandoles et même de coussins de sièges ! La guerre battait son plein lors de mes derniers séjours car le pasteur envisageait de climatiser le temple et l’avait peut être déjà entrepris, ce qui provoquait l’ire de notre curé, un capucin italien, aussi expansif en arabe qu’en anglais Il prononçait des sermons enflammés pour obtenir plus de subsides de la part de paroissiens réticents, pour la plupart goanais ou libanais.
5 - Histoire de mon poignard (Rhandjar)
Nous allions de temps à autre nous aventurer vers les lisières du Rub’al-Khâli, le vaste désert qui sépare les Emirats de l’Arabie Saoudite, pour repérer au pied de la pente abrupte des dunes, s’il s’y trouvait des lentilles humides résultant de la concentration nocturne des rosées sur leur relief. En effet, on y constatait parfois des affleurements d’humidité qui pouvaient être suffisants pour qu’une végétation xérophile s’y développe. C’est d’ailleurs là que je découvris grâce au botaniste de l’IEMVT, le fameux mésembryanthémum que je redécouvris vingt ans plus tard dans le jardin exotique de Sanary et qui, depuis, a envahi tous les jardins de Provence. Nous avions aussi initialement envisagé la possibilité, vite abandonnée, d’y créer quelques uns de ces fameux oasis artificiels prévus dans le contrat si les lentilles observées se révélaient être de petites nappes.
Ce fut l’occasion de belles randonnées au pied de ces dunes immenses, aussi majestueuses qu’inquiétantes et de « frôler» le plus formidable désert que j’aie jamais vu. Mais, à mon grand regret, il ne me fut pas possible de pousser jusqu’à l’oasis de Liwa, le plus grand et le plus lointain des oasis dépendant de l’Emirat car nous n’étions pas équipés pour de telles incursions.
Or, un jour, alors que nous étions arrêtés dans un creux entre deux dunes, vint à passer un bédouin sur son chameau. Nous croyant en panne, il s’approcha et selon la tradition bédouine, nous offrit de l’eau. Polis et respectueux des coutumes, nous l’acceptâmes et en bûmes en sa présence bien que, sortant de son outre en peau de chèvre, elle soit chaude et nauséabonde. Après force salamalecs (réels en arabe « Salam aleikhoum ») notre bienfaiteur s’en alla.
Un peu plus tard, nous fîmes une pause-déjeuner et nous vîmes revenir notre ami. Toujours polis, nous lui proposâmes des victuailles. Il ne se le fit pas dire deux fois et se mit à manger tout ce que nous avions, même le jambon et le pâté !
La glace étant définitivement rompue entre nous, une conversation - par signes plus que par mots – s’engagea. Avisant alors le poignard que, comme tout bédouin, il portait à la ceinture, je lui fis comprendre que j’aimerais le lui acheter. Il finit par accepter et me le vendit - fort cher, je crois - et repartit après m’avoir demandé de surcroît de lui donner mon couteau de pique nique, un Opinel à virole tournante pouvant bloquer la lame ouverte qui l’avait séduit durant le repas.
Je rentrai au campement, tout fier de mon emplette, pour découvrir que notre responsable permanent, plus malin que moi, en avait déjà obtenu un, plus beau car brodé de fils d’or alors que le mien était en fils d’argent. De plus le sien avait la curieuse particularité de comporter, dans un petit fourreau disposé derrière, un couteau de cuisine. Le grand poignard était, paraît-il, fait pour égorger les chameaux ou les chèvres ; le petit couteau pour préparer les morceaux à griller.
6 - Une incursion à Dubaï
Je ne suis allé à Dubaï qu’une seule fois à la demande de son Gouvernement qui voulait rivaliser avec son riche voisin. Dubaï n’avait pas de pétrole mais cependant quelques moyens grâce à son port -par lequel transitaient quantité de marchandises et qui était alors la base du trafic de l’or dans la région mais pas encore celle de l’opium.
Aussi, les autorités voulaient elles, non seulement construire une autoroute reliant Dubaï aux Emirats voisins pour améliorer le transit des importations, mais encore le border de zones boisées à l’instar de ce que nous faisions à Abu Dhabi.
Si le projet d’autoroute était raisonnable, compte tenu de l’importance du port, car il aurait effectivement facilité le trafic jusque vers Oman à l’est, Qatar et Koweït à l’ouest et nord-ouest, le projet de son boisement était irréalisable. Il m’a donc fallu expliquer que le tracé de cette route longeait de très près le golfe et que, en conséquence, la nappe phréatique y était trop salée et trop proche de la surface pour que l’on puisse envisager de l’utiliser pour l’irrigation.
Mes interlocuteurs étaient tellement accrochés à leur projet qu’ils ont été jusqu’à me demander si on ne pouvait pas utiliser des arbres en plastique ! (le syndrome du « palmier en zinc » sans doute). J’ai du me retirer avec autant de diplomatie que possible en leur expliquant que ma société ne savait pas faire cela et qu’il vaudrait mieux qu’ils s’adressent à un bureau d’études local, par exemple Sir Alexander Gibbs and partners… c’était notre principal concurrent et adversaire dans la région !.
Je fus d’ailleurs stupéfait par la vitalité de ce port, le va-et-vient incessant de boutres arrivant à pleine charge et repartant quasiment à vide. En outre, j’eus l’occasion de voir quelques dockers débarquant d’un très quelconque petit cargo des centaines de lingots d’or pour les charger sur un petit chariot puis le tirer-pousser avec effort vers une destination inconnue, suivis nonchalamment par un militaire armé d’une vague pétoire.
Une autre surprise fut de découvrir l’importance et la richesse des souks où les bijoutiers étaient déjà plus nombreux que les vendeurs de vêtements et dont les échoppes branlantes étaient en partie climatisées à la va comme je te pousse. C’est là que je ai acheté à mes fils les fameuses desert boots « Clark’s », si à la mode à l’époque et dont le slogan publicitaire « With these shoes we won Rommel », était omniprésent ici.
Dubaï ne comptait à l’époque, en dehors des caravansérails traditionnels, qu’un seul hôtel de type occidental, le « Carlton » ; prévenu, je réservais une chambre bien à l’avance pour m’entendre dire qu’il n’y avait plus que des « suites de luxe » disponibles. En fait, quand j’allais y poser mon bagage, je découvris que cette suite avait peut-être été autrefois « de luxe » mais que s’y alignaient six lits de camp que chaque client, européen ou arabe, avait payé au prix d’une « suite de luxe » . En compensation, peut-être, j’ai bénéficié après dîner d’une soirée de cabaret, moitié danse du ventre, moitié strip tease qui, visiblement, ravissait les clients arabes !
7 - Un passage imprévu à Bahreïn
(Cette île-sultanat n’est mentionnée qu’en raison d’un arrêt forcé mais folklorique que je fus contraint d’y faire)
Dans ces temps lointains, la circulation intra-régionale ne pouvait être qu’aérienne faute de routes ; seuls les nomades du cru se risquaient à de longues traversées avec leurs caravanes de « chameaux », en fait des dromadaires mais le nom anglais : « dromedary » n’y était pas employé.
Il faut d’ailleurs rappeler à ce propos que tous ces Etats du golfe Persique, de Koweït à Oman, sont séparés de l’Arabie saoudite par un vaste désert, le Rub’al-Khâli, surnommé « the empty quarter » par les Anglais, aux dunes de hauteur colossale et sans aucun oasis.
Selon ce qui m’a été dit, il n’aurait été traversé pour la première fois par les Anglais qu’en 1942 et ce fut le haut fait des « long range desert scouts » - probablement équipés de « desert boots » produites par « Church’s qui s’illustrèrent par la suite dans la campagne de Libye.
Les horaires élastiques de la « Gulf Aviation » dont j’ai donné un aperçu à propos de la présence anglaise firent que je dus passer la nuit à cette escale imprévue. Sans visa, je fus confiné dans la salle sous douane de l’aéroport dont le bar était fermé. J’en étais le seul occupant sous la surveillance approximative d’un policier muni d’un fusil qui l’encombrait plus qu’il n’ajoutait à sa prestance. La pièce ne comportait qu’un fauteuil dont mon gardien, sans doute fatigué par ce genre de service exténuant, s’empara pour s’y endormir, son arme entre les jambes. Aussi, dès qu’il refit brièvement surface entre deux ronflements, je lui fis comprendre par gestes expressifs, faute de parler arabe, qu’après tout, c’était moi le client, donc prioritaire pour ce siège. Le malheureux me laissa la place à regret pour aller s’allonger au pied d’un mur et je pus achever cette courte nuit plus confortablement qu’assis sur ma valise.
Une autre anecdote me revient à propos des escales et des bars d’aéroport, située à Bahreïn ou dans un autre émirat. En transit, allant de quelque part à ailleurs, je m’étais installé au bar de l’aéroport en attendant ma correspondance quand deux européens inconnus vinrent s’attabler près de moi. Ils discutaient en français d’une proposition qu’ils devaient prochainement remettre mais je ne me souviens plus de son objet ni de leur client potentiel. Tranquilles car se trouvant dans un pays où l’on ne parle qu’arabe ou anglais, ils s’entretenaient très librement de leur affaire. C’était deux ingénieurs de la SCET-Inter, un de nos principaux concurrents français dans la région, que je ne connaissais pas. Bien entendu, je me suis abstenu de leur révéler ma nationalité et nous sommes partis, chacun de notre coté, sans échanger un mot.
Cette rencontre m’a servi de leçon et, de ce jour, je n’ai jamais parlé affaires dans un bar d aéroport que ce soit en français ou en anglais ! D’ailleurs, j’ai pu assister à une situation du même ordre quelques temps plus tard, au Sri Lanka, avec un groupe de touristes français qui, dans une guest house, critiquaient le repas qu’ils venaient de prendre (ces imbéciles avaient choisi le menu dit « occidental » toujours mauvais dans ce genre d’auberges de brousse) et se moquaient des serveurs et, en particulier du maître d’hôtel dont je savais qu’il parlait français. Je me suis cru obligé de les excuser après leur départ mais je n’avais pas osé leur faire des remontrances.
8 - A propos du sultanat d’Oman
J’aurais bien aimé aller visiter le sultanat d’Oman, plus moderne que les émirats du golfe car il était dirigé depuis quelques années par un jeune sultan moderne et moderniste. Il avait déposé son père par une révolution de palais et, après cette élimination, il se débarrassait progressivement d’une tradition étouffante.
Je pensais pouvoir y trouver des espèces d’arbres adaptées à ces climats extrêmes, peu exigeantes en eau et acceptant l’eau saumâtre, susceptibles d’élargir la gamme de celles que nous utilisions pour nos plantations (eucalyptus, albizzia…)
Oman était considéré comme riche bien que sans pétrole, et fertile dans les fonds de vallée irriguées des contreforts du djebel. La pêche était également très active mais sa production peu exportée sauf sous forme de poisson séché. C’était, à ma connaissance, le seul pays où le poisson non utilisé était employé comme engrais : les poissons morts étaient alignés à la queue leu leu dans les sillons, puis recouverts de terre et pourrissaient lentement entre les rangées de tomates.
Je n’ai pu m’y rendre pour m’y livrer à l’exploration botanique projetée et y voir cette pratique car, curieusement dans un pays indépendant, les visas étaient délivrés pas la Shell qui ne les donnait pas à n’importe qui et surtout pas à un français car la C.F.P. (Total) était déjà solidement implantée à Abû Dhabi.
J’ai appris depuis, sans jamais le constater de visu, que le poisson-engrais était une pratique courante en Chine et en Corée.
10 - Brève découverte du Koweït et du Qatar
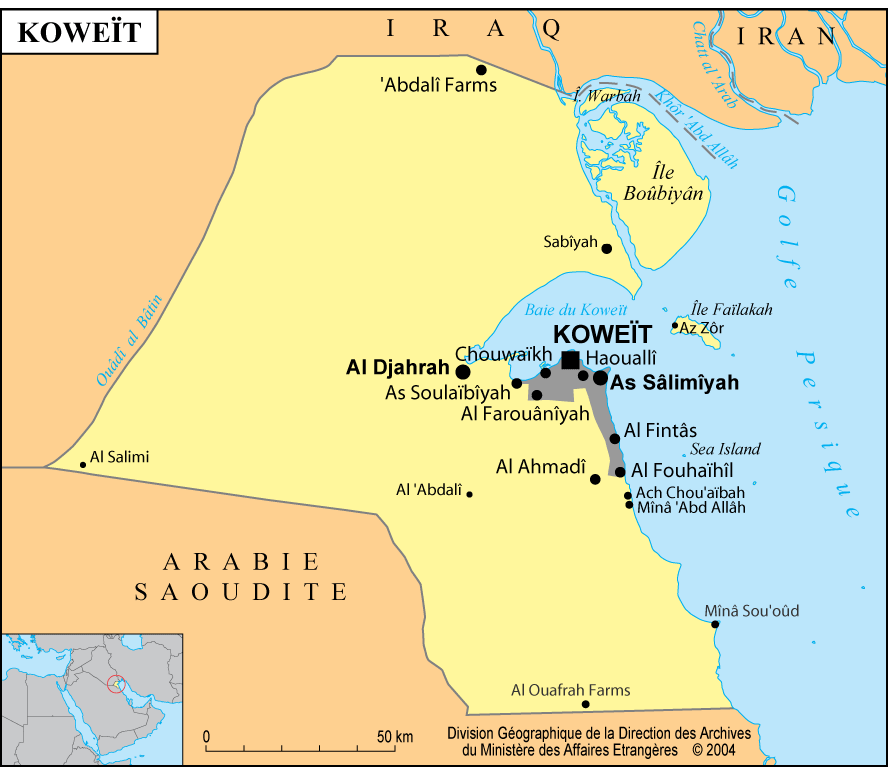
Je ne dirai pas grand chose de ces pays où je n’ai passé que quelques jours mais en plein mois de juillet. J’y allais pour accompagner un commercial, ingénieur de la maison, qui tentait de prôner, en vue d’une problématique vente ultérieure, des fermes maraîchères et des unités de serres climatisées.
Je savais que Koweït était un pays « sec » mais j’eus quand même la surprise de voir le douanier, à l’arrivée, fouiller méticuleusement mes bagages et vider mes flacons d’eau de Cologne et d’after-shave car ils contenaient de l’alcool ! En revanche, logeant à l’hôtel Hilton, je remarquais, à une table voisine, un groupe de libanais qui se faisait servir force tasses de thé avec de belles théières en cuivre. Intrigué, j’interrogeais le serveur, libanais également, qui, riant sous cape, me répondit qu’il s’agissait de whisky et non de thé mais que çà avait la même couleur ! Il y avait donc des passe-droits et des arrangements avec la loi coranique ! Cette histoire d’alcool se termina le mieux du monde car, revoyant notre ambassadeur, il nous demanda si nous étions « secs ». Sur notre réponse affirmative, il nous invita à la résidence pour boire une bouteille de Bordeaux en guise d’apéritif.
Autre surprise : le jeudi soir, la ville se vida. Notre chauffeur, interrogé, nous expliqua que les gens aisés n’oubliaient pas leurs racines nomades et que, à la saison « chaude », ce qui était vraiment le cas, ils allaient passer le week end dans le « désert ». Il nous conduisit à quelques kilomètres à l’extérieur à la nuit tombée. Là, nous vîmes des familles entières rassemblées à proximité de leur grande tente bédouine (sûrement montée le matin par les domestiques) et préparant leur barbecue de kébab avec la Mercedes garée à proximité. Les tentes des uns et des autres étant proches, on s’interpellait dans une atmosphère familiale et joyeuse, dans la fraîcheur relative, dans la perspective d’un agréable week end.
Quant au Qatar, n’y ayant passé qu’une journée, je n’ai visité que des bureaux, d’ailleurs sans succès pour nos affaires. En revanche, un rapide tour de la ville de Doha organisé par un de nos aimables interlocuteurs, me permit de découvrir une cité moderne et verdoyante avec des promenades, parcs et jardins admirablement entretenus, à l’opposé de Dubaï et même d’Abu-Dhabi. La présence occidentale y était très visible, l’une expliquant probablement l’autre.

11 - Vadrouilles commerciales au Liban et en Jordanie
Ce projet était un gros consommateur d’intrants et de fournitures diverses qui ne pouvaient être trouvées sur place. Il fallait donc aller les acheter à l’extérieur.
Si nous n’avions pas à nous préoccuper du matériel de forage fourni par le sous-traitant ou de leur tubage commandé, livré et réceptionné par nos services d’hydraulique et d’hydrogéologie, nous devions préciser et suivre les commandes du matériel d’irrigation (tuyaux, pompes, goutte à goutte…) et les réceptionner.
Je dus donc aller faire des achats dans les pays voisins : des plants aux pépinières royales à Amann en Jordanie ainsi qu’au « Plan vert » du service forestier du Liban. Engrais, pesticides, petit matériel agricole (ah ! les fameux Vermorel !) furent achetés à Beyrouth au « Comptoir Agricole du Levant » dont le propriétaire et directeur était un jeune Agro qui m’avait été indiqué par l’association des anciens élèves comme un très bon contact. C’est avec lui que je découvris que, durant l’été, très chaud à Beyrouth, les familles riches transféraient dans la montagne, non seulement leur domicile, mais aussi leurs bureaux ! En outre, il prétendait (mais je n’ai pas vérifié) que les fonctionnaires libanais ne travaillaient été comme hiver que quatre jours par semaine, le vendredi étant férié à cause des musulmans, le samedi à cause des israélites et le dimanche à cause des chrétiens.
Mon principal tour fut tellement important que je dus louer un avion cargo de la Middle East Airlines qui refit le même périple que moi pour rapporter mes emplettes à Abû Dhabi.
Il fallait également faire face à l’imprévu. Ce fut le cas des attaques de chameaux qui, affamés d’herbe fraîche et guidés par leurs propriétaires, venaient festoyer sans vergogne dans nos plantations. Nous dûmes commander en catastrophe deux ou trois kilomètres de « ri bar » en Tunisie.
Les ri bars étaient des gros rouleaux de fil de fer barbelé d’environ un mètre cinquante de diamètre qui avaient été utilisés par l’armée française pour interdire le passage en Tunisie des fellagas qu’elle pourchassait. Il en subsistait de gros stocks sur place qui étaient revendus comme « surplus militaires ».
La clôture de nos plantations par un seul ri bar s’est vite révélée insuffisante pour arrêter les chameaux du voisinage car les propriétaires apportaient des planches pour faciliter l’entrée des bêtes. La surveillance nocturne n’y changeait rien car les chameaux comme les bédouins courent vite et aucune sanction n’était possible. Nous n’eûmes finalement la paix qu’en superposant trois ri bars et…en distribuant quelques bakchichs !
12 - La fin du projet
En définitive ce projet s’est achevé sans moi mais j’en avais confié la fin à un agronome sûr et expérimenté antérieurement producteur d’oranges au Maroc, que j’avais pu recruter avec la complicité de mon patron du moment à Grenoble.
Je regrette vraiment de n’avoir pas pu le conduire à son terme, d’autant plus que je n’ai jamais eu l’occasion de repasser par là pour en voir le résultat. Je me demandais et me demande encore s’il reste quelque chose de cette entreprise réalisée avec des moyens qui seraient maintenant considérés comme artisanaux.
Peu de temps après mon départ de SOGREAH, J’ai cependant su par le pépiniériste qui était venu me revoir à Paris, que l’entretien des plantations avait été confié à une entreprise pakistanaise et que çà poussait « comme çà pouvait ». Pour lui, le technicien rigoureux formé aux pépinières Treyve, ce projet avait été un peu son enfant et il avait pu observer, durant quelques années, l’évolution des bandes forestières. Il était en effet, demeuré sur place après la fin du projet car il avait été recruté par C.F.P. - TOTAL pour réaliser puis diriger la ferme maraîchère et fruitière d’Al Aïn dont SOGREAH avait fait l’étude. Il avait malheureusement été licencié pour être remplacé par un arabe musulman quelconque placé sous la direction, honorifique mais probablement incompétente, d’un Abû Dhabien de souche.
J’ai cependant appris récemment par la presse que l’émirat d’Abû Dhabi serait en train de créer une « ville verte » nommée MASDAR. Elle devrait être sans voitures et sans aucune activité polluante !
En outre la France est toujours et de plus en plus présente dans cet émirat qui m’avait conquis il y a près de cinquante ans, avec les créations d’une université rejeton de notre Sorbonne, d’un musée annexe du Louvre et, enfin, d’une base militaire bien utile pour y stationner nos Mirage intervenant en Syrie.
Bernard SIMON Juin 2017
Nota :*1* Je n’ai pas jugé utile de mentionner les noms des divers intervenants qui ont participé à ce projet car ils ne seraient connus que de rares anciens de Sogreah. Ceux avec lesquels j’avais conservé des relations après mon départ sont hélas ! décédés ou disparus.
*2* Je dispose encore de quelques diapositives qui pourraient être utilisées pour l’illustration de cet article/
Date de dernière mise à jour : 2018-03-07